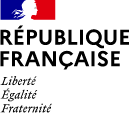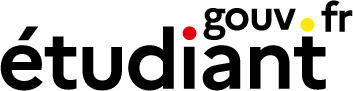Concours | Jeunes Reporters pour l'Environnement
Sensibilisez aux enjeux climatiques, à la biodiversité, à la réduction des inégalités, en réalisant votre propre reportage.
C'est quoi ?
Le concours Jeunes Reporters pour l'Environnement s'inscrit dans une démarche que l'on appelle le journalisme de solution. Le reportage doit d'un côté dresser un constat, rendre compte d'une problématique locale, tout en présentant une solution. Celle-ci peut être apportée par une association, des citoyens, une institution... Ce concours est soutenu par de nombreuses institutions, dont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Pour qui ?
Vous pouvez participer à titre individuel ou en équipe, via une association étudiante par exemple. Même si vous n'avez jamais fait de reportage, que vous n'êtes pas en études de journalisme ou de communication, n'hésitez pas à vous lancer si un sujet vous tient particulièrement à cœur, vous serez accompagné.
Il faut faire quoi ?
- Choisir une problématique locale de développement durable parmi les 17 définies par l'ONU
- Mener l'enquête, à votre échelle, sur les causes et solutions en lien avec cette problématique
- Réaliser un reportage qui présente des acteurs de terrain agissant sur cette problématique
- Diffusez ce reportage pour sensibiliser un maximum de personnes à cette problématique
Comment participer ?
- Envoyez un article (1 000 mots)
- Ou une vidéo (3 minutes)
- Ou un podcast (3 minutes)
Besoin d'aide ?
C'est sur jeunesreporters.org que vous trouverez toutes les infos pour vous lancer !
Vous y trouverez une boite à outils avec des tutos, le règlement, mais aussi des reportages des années précédentes pour trouver l'inspiration - et vous décomplexer. L'association qui organise le concours (Teragir) répond à vos questions. Si vous avez besoin d'un accompagnement complémentaire, vous pouvez contacter un membre de l’équipe Jeunes Reporters pour l’Environnement.
Quelques exemples de reportages récompensés
Le pirarucu
Lors de son séjour en Colombie, dans le cadre de son cursus à Sciences Po Grenoble, Anne-Flore a réalisé un reportage sur le pirarucu, poisson emblématique d'Amazonie menacé d'extinction dans les années 2000.
Graines populaires
C'est le nom de l'association que Charlotte a suivi dans le cadre de son reportage. Problématique explorée : la sensibilisation aux enjeux climatiques, à l'école, dans les quartiers populaires mais aussi à l'international, dans les pays du Sud. Charlotte a suivi les actions de l'association, qui souhaite décloisonner l'écologie et démocratiser les pratiques éco-responsables.